02 Mar NEWSLETTER MARS 2021
- Droit du travail et sécurité sociale
- Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Cour de Justice de l’Union Européenne
– Droit du travail et sécurité sociale –
PHARMACIE – CONVENTION COLLECTIVE.
Cass., Soc., 17 février 2021, 18-24243.
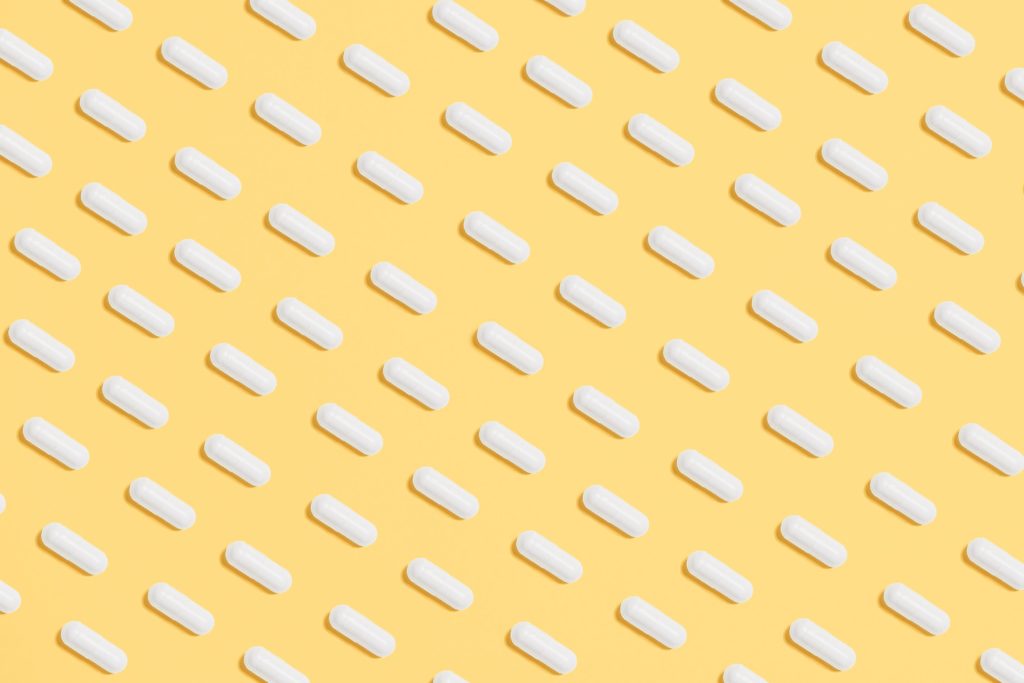
M. T… a été engagé à compter du 21 novembre 2009 par la société Pharmacie des archives en qualité de pharmacien. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 3 juillet 2012.2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos compensateur d’égale durée à prendre, en accord avec l’employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d’une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu’il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d’un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche.
Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre des dimanches travaillés, l’arrêt retient que le salarié est bien fondé dans son principe à réclamer l’application des dispositions de la convention collective relativement aux dimanches travaillés et aux jours fériés travaillés au motif que la convention collective ne distingue pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu’elle n’est ouverte que pour assurer un service de garde, que la mention « dimanche de garde » dans ce texte n’emporte pas la distinction qu’invoque l’employeur.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
TRAVAIL TEMPORAIRE – ACCIDENT DU TRAVAIL.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°18-15972.
M. E… a été engagé par les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50 pour être mis à la disposition de la société I… (la société), en qualité de manoeuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012.
A cette dernière date, il a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail puis en invalidité et placé sous la curatelle de l’UDAF de la Manche.
Le salarié assisté de son curateur a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture.
La société I… a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2019 et la Selarl […] désignée en qualité de liquidatrice.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2008 à 2011, l’arrêt retient que l’intéressé expose que la situation n’était pas nouvelle en 2012, que depuis le début de la relation de travail il accomplissait des heures supplémentaires attestées par son entourage et il présente, pour la période 2008-2011, un décompte (« forfaitaire » selon ses propres termes) établi sur la base du décompte de 2012. Il retient encore que la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés. Il ajoute que pour le surplus correspondant aux années antérieures à l’année 2012, la réclamation ne saurait être considérée comme étayée par la seule affirmation que « des heures supplémentaires ont été faites » et la présentation d’un décompte établi sur la base forfaitaire des heures réalisées en 2012.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l’arrêt retient que l’accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n’a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n’a pas été l’accident du travail mais la survenance de ce terme.
En statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu’au 2 septembre 2015, en sorte qu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s’analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés.
CONVENTION COLLECTIVE – TRAVAIL DOMINICAL.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-21897.
M. D… a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d’employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d’être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services» à compter du 2 juin 2008.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires en reprochant notamment à son employeur de l’avoir privé du repos compensateur auquel il pouvait prétendre au titre du travail le dimanche.
D’abord, il résulte de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 9 novembre 2017 C-306/16), que ce texte se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d’aménagement du temps de travail. Si chaque travailleur doit bénéficier d’un jour de repos pris au cours de chaque période de sept jours, la directive laisse toutefois une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée, le jour de repos hebdomadaire des travailleurs n’étant donc pas nécessairement le dimanche et les États membres pouvant appliquer ou introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Ensuite, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.
Après avoir relevé qu’à compter du 29 octobre 2007, la société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, puis qu’à compter du 5 janvier 2008, elle avait bénéficié des nouvelles dispositions de l’article L. 221-9 devenu l’article L. 3132-12 du code du travail, ayant autorisé de plein droit les établissements de commerce de détail d’ameublement à déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir, pour la période antérieure au 29 octobre 2007, ni des dispositions de l’article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire, en contrepartie d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire, ni de celles de l’article L. 3132-25-3 du même code prévoyant un repos compensateur et une rémunération augmentée pour les salariés privés du repos dominical après une autorisation accordée par le préfet, puisque le litige ne s’inscrivait pas dans le cadre légal du travail le dimanche autorisé par le maire ou par le préfet.
Ayant ensuite constaté que le salarié travaillait de façon habituelle le dimanche, elle en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure au 5 janvier 2008, au repos compensateur prévu par l’article 33 de la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche.
CONTRAT DE MISSION – PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-14812.
M. B… a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009. Le 20 novembre 2009, le salarié a rompu le contrat de mission.
Le 3 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées à l’encontre de la société de travail temporaire, imputant notamment à cette dernière la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Les dispositions de l’article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n’entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l’article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l’absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l’entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l’arrêt retient que selon l’article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’entreprise de travail temporaire ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, ne lui avait pas fourni les équipements de protection notamment le casque et les chaussures sécurité et qu’il avait subi un préjudice distinct, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
CONTRAT D’APPRENTISSAGE – RESILIATION.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-25746.
M. O… a été engagé à compter du 15 juillet 2013 aux termes d’un contrat d’apprentissage par la société d’Exploitation des établissements Muret (la société).
Les parties ont signé le 21 octobre 2013 une constatation de rupture du contrat d’apprentissage.
Contestant la rupture, M. O… a saisi la juridiction prud’homale.
L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. O… une somme représentant les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, alors « que le contrat d’apprentissage ne pouvant être rompu que sur accord écrit signé des deux parties ou judiciairement, la rupture matérialisée par la signature d’une « Constatation de rupture du contrat d’apprentissage » est nécessairement d’un commun accord ; qu’en jugeant que la preuve n’en était pas rapportée aux motifs inopérants de la présence sur le formulaire des cases « commun accord » et « autre », et que seule cette dernière avait été cochée, la cour d’appel a violé l’article L 6222-18, alinéa 2, du code du travail dans sa version applicable. »
Aux termes de l’article L.6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Pour condamner l’employeur à payer à M. O… une somme représentant les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, l’arrêt retient que le document de constatation de rupture a été signé par l’employeur, le représentant légal et l’apprenti, que la seule signature par les parties d’un document de constatation de rupture du contrat d’apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d’un commun accord du contrat, que deux cases sont prévues, l’une intitulée “rupture d’un commun accord”, la seconde, “autre “, que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée, et que ces documents révèlent que le motif “commun accord” n’a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d’apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PORTAGE SALARIAL – CONGES PAYES.
Cass., soc., 11 février 2021, n°20-70005 (Demande d’avis n°F 20-70005).
La demande est ainsi formulée :
« – Le congé exceptionnel de l’article L. 3142-1 du code du travail est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L.1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ?
– Dans ce cas, n’est-ce pas en contradiction avec l’article L.1254-21-II du code du travail qui précise que les périodes sans prestations à une entreprise ne sont pas rémunérées ?
– Dans le cas contraire, l’acquisition de congés payés prévue par l’article L.3142-2 du code du travail est-elle compatible avec l’absence de rémunération des congés ? »
Examen de la demande d’avis
Ces questions de droit, qui sont nouvelles et qui présentent une difficulté sérieuse, sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. La demande d’avis est dès lors recevable.
Selon l’article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions relatives aux congés sont applicables aux entreprises de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Il en résulte qu’en l’absence de dispositions légales contraires, elles sont applicables aux entreprises de portage salarial ainsi qu’aux salariés portés.
Selon l’article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence.
Selon l’article L. 3142-2 du code du travail, les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Aux termes de l’article L. 1254-21 II du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence bénéficie de jours d’absence dans les conditions prévues par la loi et sans réduction de sa rémunération, et que ces jours d’absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.
En conséquence, la Cour :
EST D’AVIS QUE :
1°/ Les jours d’absence prévus pour certains événements familiaux dont est susceptible de bénéficier un salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque surviennent ces événements ne peuvent entraîner une réduction de la rémunération de celui-ci et sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.
2°/ Le salarié porté ne pouvant prétendre à un congé à l’occasion d’un événement familial que si cet événement survient alors qu’il effectue une prestation pour une entreprise cliente, les dispositions de l’article L. 1254-21 II du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer dans cette hypothèse.
3°/ La réponse apportée à la première question rend la troisième question sans objet.
Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence bénéficie de jours d’absence dans les conditions prévues par la loi et sans réduction de sa rémunération, et que ces jours d’absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.
PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL – CONTRAT DE MISSION.
Cass., Soc.,17 février 2021, n°19-14812.
M. B… a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009. Le 20 novembre 2009, le salarié a rompu le contrat de mission.
Le 3 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées à l’encontre de la société de travail temporaire, imputant notamment à cette dernière la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Les dispositions de l’article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n’entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l’article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l’absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l’entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l’arrêt retient que selon l’article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’entreprise de travail temporaire ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, ne lui avait pas fourni les équipements de protection notamment le casque et les chaussures sécurité et qu’il avait subi un préjudice distinct, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
APPRENTISSAGE – RUPTURE DU CONTRAT.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-25746.
M. O… a été engagé à compter du 15 juillet 2013 aux termes d’un contrat d’apprentissage par la société d’Exploitation des établissements Muret (la société).
Les parties ont signé le 21 octobre 2013 une constatation de rupture du contrat d’apprentissage.
Contestant la rupture, M. O… a saisi la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L.6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Pour condamner l’employeur à payer à M. O… une somme représentant les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, l’arrêt retient que le document de constatation de rupture a été signé par l’employeur, le représentant légal et l’apprenti, que la seule signature par les parties d’un document de constatation de rupture du contrat d’apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d’un commun accord du contrat, que deux cases sont prévues, l’une intitulée “rupture d’un commun accord”, la seconde, “autre “, que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée, et que ces documents révèlent que le motif “commun accord” n’a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d’apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
TRAVAIL – REGLEMENTATION – DUREE DU TRAVAIL.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°18-26545.
Mme X… et sept autres salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo (la société), ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Selon l’article 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l’issue de la période de modulation.
Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l’employeur à payer diverses sommes à ce titre, les arrêts retiennent qu’en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.
Les arrêts ajoutent qu’au regard de ces éléments, l’employeur est dans l’incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu’il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l’accord d’entreprise.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l’accord d’entreprise, sans vérifier si les salariés n’avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu’ils étaient placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils se trouvaient dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l’accord d’entreprise du 11 mai 2005.
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE – TRANSACTION.
Cass., Soc., 17 février 2021, n°19-20635.
Mme X… a été engagée, le 1er février 1988, par la société Markem Imaje Industries, en qualité d’assistante service ressources humaines.
Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
Le 16 mars 2015, elle a été licenciée pour motif personnel.
Les parties ont signé un protocole transactionnel le 30 mars 2015.
Le 27 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Pour faire droit aux demandes de la salariée, l’arrêt retient que l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, que la transaction litigieuse ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée, que l’employeur ne peut en conséquence exciper de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel du 30 mars 2015 pour s’opposer à la demande en paiement formée la salariée.
En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
AMIANTE – MALADIE PROFESSIONNELLE – FONDS DE GARANTIE.
Cass., Civ., 2ème, 11 février 2021, n°20-10951
B… X…, affecté d’un adénocarcinome bronchique de stade IV, diagnostiqué le 12 mai 2015, s’est vu notifier par une caisse primaire d’assurance maladie un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
B… X… a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices, avant de décéder, le […] 2015.
Mme X…, veuve de B… X…, M. C… X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D… et E… X…, et M. F… X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur G… X… (les consorts X…), ont notifié au FIVA, le 27 mars 2017, une demande d’indemnisation de leurs préjudices, ainsi que de ceux que B… X… avait subis.
En l’absence de réponse du FIVA à l’expiration, le 27 septembre 2017, du délai dont il disposait pour formaliser une offre, les consorts X… ont saisi, le 15 novembre 2017, une cour d’appel d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par celui-ci.
En cours de procédure, par lettre recommandée du 23 mars 2018, le FIVA a notifié aux consorts X… un refus exprès d’indemnisation.
Selon l’article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, le FIVA doit présenter une offre d’indemnisation dans les six mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite et le requérant ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds que si aucune offre ne lui a été présentée dans ce dernier délai, si sa demande d’indemnisation a été rejetée, ou bien encore s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
Selon l’article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige,, le délai pour agir devant la cour d’appel, qui est de deux mois, court, soit à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, soit du jour où intervient la décision implicite de rejet du fonds lorsque, à l’expiration du délai de six mois prévu par le premier de ces textes, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision implicite de rejet prise par le FIVA est recevable, la cour d’appel est régulièrement saisie de la demande d’indemnisation et le requérant n’est pas tenu de former un nouveau recours à l’encontre d’une décision expresse de refus d’indemnisation notifiée par le fonds en cours de procédure.
Pour déclarer sans objet le recours initialement engagé par les consorts X… à l’encontre de la décision implicite de rejet prise le 27 septembre 2017 par le FIVA, et déclarer leurs demandes d’indemnisation irrecevables, l’arrêt énonce que le refus d’indemnisation notifié aux consorts X… le 23 mars 2018 s’est substitué au refus implicite qui avait justifié la saisine de la cour, en novembre 2017, et retient qu’il a rendu sans objet le recours engagé le 15 novembre 2017.
L’arrêt ajoute que ce refus explicite n’a pas été contesté dans le délai de deux mois expressément mentionné dans la notification du 23 mars 2018, retient que le refus du FIVA était déjà devenu définitif lorsque les consorts X… en ont pris acte et l’ont contesté, par leurs conclusions reçues par le FIVA le 16 septembre 2019 et en conclut que les demandes d’indemnisation des consorts X… sont irrecevables.
En statuant ainsi, alors que les consorts X… avaient contesté en temps utile la décision implicite de rejet prise par le FIVA et avaient maintenu leur contestation, après le refus d’indemnisation notifié par le FIVA en cours de procédure, de telle sorte que leur recours, qui avait conservé son objet, ne pouvait pas être jugé irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés / l’article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, l’article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL – ORGANISATIONS SYNDICALES.
Cass., Soc., 10 février 2021, n°19-13383.
La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ». L’accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 10 juin 1994. Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d’une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB.
Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l’APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l’avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017. Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion.
Invoquant un trouble illicite pour n’avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance. La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de l’article L. 2262-10 du code du travail, lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Ayant constaté que l’action concernait les conditions de révision d’un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré recevable l’intervention volontaire de cette organisation d’employeurs.
En application de l’article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Aux termes de l’article L. 2122-5 du code du travail, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
Selon l’article L. 2121-2 du code du travail s’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête. L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose.
Selon l’article L. 2122-11 du code du travail en son premier alinéa après avis du Haut conseil du dialogue social le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
S’agissant d’un accord de branche professionnelle, en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail.
Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d’organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés aux fins de « permettre l’expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés », que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et qu’il n’existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d’application de plusieurs accords de branche, d’arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.
La cour d’appel a constaté que les organisations patronales à l’origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu’elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L.2121-2 et L.2122-11 que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail.
Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L.2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
REPRESENTATION DES SALARIES – CES.
Cass., Soc., 10 février 2021, n°19-14021.
Aux termes de l’article 9-III de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.
Il en résulte qu’un accord qui prévoit la mise en place d’un comité social et économique à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d’entreprise qui prennent fin au jour de la mise en place du comité social et économique.
La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.
C’est dès lors à bon droit, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, qu’une cour d’appel qui relève de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d’un hôtel par usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’hôtel, interpellation des salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée, a pu, au regard de ces comportements qu’elle estime abusifs, dire justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès à l’absence d’utilisation de matériel sonore et d’entrée dans les chambres de l’hôtel.
Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.
Viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret de Fructidor an III la cour d’appel qui accueille la demande de l’employeur tendant à interdire aux salariés grévistes et à toute personne agissant de concert avec eux d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel et à être autorisé à défaut à faire appel à la force publique.
– Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation –
PRESENTATION OU PUBLICATION DE COMPTES INFIDELES.
Cass., Crim., 17 février 2021, n°20-82068.
Le 16 novembre 2015, la société Dynamique hôtels a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de comptes inexacts, complicité de ce délit, et de non dénonciation de faits délictueux.
Dans sa plainte, elle expose que le groupe CBRE, n°1 mondial du conseil immobilier aux entreprises, a constitué la société Dynamique hôtels en 2006, présidée par la société CBRE Investors (CBRE I), et ayant pour objet la réalisation d’investissements dans le domaine de l’hôtellerie par le biais d’acquisition de murs et/ou de fonds de commerce d’hôtellerie et la prise de participations dans des sociétés françaises ou étrangères exerçant dans le domaine de l’hôtellerie.
Entre fin 2006 et début 2008, la société Dynamique hôtels a acquis une centaine d’hôtels, mais en 2009, après qu’elle eût clôturé un deuxième exercice consécutif déficitaire, plusieurs sociétés du sous-groupe ont fait l’objet d’une procédure collective avec ou sans poursuite d’activité et la société CBRE I a été remplacée à la tête de la société Dynamique hôtels par la société Parfires en 2010.
La société Dynamique hôtels, estimant avoir subi un préjudice financier en raison des agissements de la société CBRE I, a sollicité une expertise comptable auprès du cabinet Abergel qui a conclu que la seconde aurait procédé à une survalorisation des actifs de la première dans les comptes consolidés de 2009 afin de dissimuler les fautes de gestion commises au cours de son mandat et a estimé la valeur de ces actifs au 31 décembre 2009 à la somme de 106 234 000 euros alors que la somme de 222 854 000 euros figurait dans les comptes présentés pour l’année 2009.
Les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 ont été approuvés, avec le soutien du commissaire aux comptes, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010 et ce n’est que par la suite qu’il s’est avéré que les associés avaient été trompés.
Le 27 avril 2016, une information judiciaire a été ouverte du chef de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, faits susceptibles d’avoir été commis à Paris le 23 juin 2010, à l’issue de laquelle le magistrat instructeur a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque par ordonnance du 23 novembre 2018 qui a fait l’objet d’un appel de la part de la partie civile.
Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société Dynamique hôtels en date du 23 juin 2010, que ce sont les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010 qui ont été présentés à l’approbation, énonce que la présentation de comptes annuels consolidés infidèles n’est pas spécifiquement réprimée par les dispositions de l’article L. 242-6 du code de commerce ou par une autre disposition de ce code.
Les juges ajoutent que dans l’hypothèse d’une survalorisation frauduleuse des actifs, la présentation de comptes consolidés peut recevoir la qualification de faux et usage, qu’il résulte des investigations que les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 de la société Dynamique hôtels ont été établis en valorisant les actifs immobiliers, à savoir les hôtels, selon la méthode dynamique, déjà utilisée lors des deux exercices précédents, qui prend en compte les flux futurs espérés de l’exploitation après rénovation des hôtels acquis.
Ils relèvent que le recours à cette méthode apparaît pertinent en raison de la signature, à l’issue de la procédure de conciliation ouverte à la demande de la société Dynamique hôtels qui rencontrait des difficultés, d’un accord signé le 15 juin 2009 avec les principaux créanciers de la société et homologué par le président du tribunal de commerce de Paris, en vertu duquel la société Parfires, désignée comme président du groupe, a élaboré un plan prévoyant la cession d’une dizaine d’hôtels ainsi que la poursuite de l’activité des autres établissements assortie des travaux nécessaires.
La cour d’appel relève que c’est à la suite d’une erreur que le cabinet Abergel a évalué le montant des travaux restant à effectuer et pris en compte pour l’évaluation desdits actifs, à un montant de 50 millions d’euros, alors qu’un montant de 23 millions d’euros figure dans l’annexe des comptes consolidés.
Elle souligne que, par l’effet de la cession d’une partie des actifs, le périmètre du portefeuille hôtelier s’est trouvé réduit à cinquante-deux hôtels, ce qui a conduit le cabinet Deloitte, qui a procédé à l’évaluation des actifs, à chiffrer à 22,7 millions d’euros le montant des travaux à entreprendre et à préciser que cette diminution de 54 % s’expliquait par une meilleure négociation des devis, une rationalisation des travaux et la suppression des travaux pour treize hôtels supplémentaires en voie de cession.
Ils énoncent que la partie civile ne peut soutenir qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements à la date d’établissement des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 puisque la Société Générale, dans le cadre de l’accord de conciliation, a accepté de proroger la maturité de ses prêts au 30 septembre 2010 et a consenti des prêts relais à plusieurs sociétés du groupe Dynamique hôtels pour financer l’insuffisance de trésorerie du groupe pour la période courant jusqu’au 31 mars 2011.
Ils relèvent également que l’un des commissaires aux comptes de la société Dynamique hôtels a expliqué que la situation de celle-ci était la conséquence des difficultés rencontrées par le groupe pour refinancer les acquisitions et les travaux dans le contexte de la crise financière.
La cour d’appel conclut qu’à supposer même que les dirigeants du groupe aient commis une erreur en engageant l’ensemble des fonds disponibles pour finaliser les acquisitions d’hôtels en Allemagne, il ne saurait en être déduit une présentation inexacte des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 par survalorisation des actifs puisqu’il a été vu que la méthode des flux futurs était justifiée par la perspective de poursuite de l’activité à la suite de l’homologation de l’accord de conciliation et la réduction significative du portefeuille hôtelier à la suite des cessions envisagées.
En prononçant ainsi, par des motifs non contradictoires et relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, c’est à bon droit qu’elle a considéré que la présentation des comptes annuels consolidés, seule à avoir été effectuée, selon ses constatations, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010, est exclue du champ d’application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles prévu par l’article L. 242-6, 2°, du code de commerce.
PLATE-FORME ELECTRONIQUE – SAISIES CONSERVATOIRES.
Cass., Civ., 2ème, 4 février 2021, n°19-12424.
La société Pixmania a exploité, jusqu’en février 2016, avant de faire l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, une plate-forme électronique mettant en relation sur un site internet spécialisé des vendeurs professionnels, parmi lesquels la société Elite GSM, avec des clients.
Par deux ordonnances du 12 février 2016, la société Pixmania a été autorisée à faire pratiquer, en garantie de la somme de 600 000 euros, d’une part, une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels, et notamment les stocks de produits finis, dont la société Elite GSM serait propriétaire et déposés entre les mains des sociétés du groupe Amazon opérant en France (Amazon EU, Amazon France services SAS, Amazon France logistique et plus généralement toute société affiliée à la société Amazon EU au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce) et, d’autre part, une saisie conservatoire sur toutes les sommes, avoirs ou valeurs dont la société Elite GSM serait “titulaire” à l’encontre des mêmes sociétés.
La société Pixmania a fait pratiquer, le 12 février 2016, une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de biens meubles corporels, notamment des stocks de produits finis, entre les mains des sociétés Amazon France services et Amazon EU en garantie de sa créance de 600 000 euros en principal.
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, la société Elite GSM a été condamnée à payer à la société Pixmania, à titre provisionnel, la somme de 740 369,71 euros au titre des remboursements effectués par la société Pixmania aux clients en garantie de produits non livrés par la société Elite GSM, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pixmania, a ensuite, fait pratiquer, les 29 février et 1er mars 2016, des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique.
Par acte du 8 juin 2016, la Selarl I…, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, a fait assigner les sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l’exécution à l’effet, d’une part, de constater le refus de répondre de la seconde aux saisies pratiquées entre ses mains le 12 juin 2016, le manquement de la première à son devoir de collaboration dans le cadre de la saisie sur stocks du 12 juin 2016 et le préjudice consécutif en étant résulté pour la société Pixmania à hauteur de la dette de la société Elite GSM, soit 680 735,62 euros, et, d’autre part, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la saisie.
Selon l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En application des deux derniers alinéas de l’article R. 221-21 du code des procédures civiles d’exécution, auxquels renvoie l’article R. 522-5 du même code, l’huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts.
La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l’accomplissement de la mesure, l’information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n’exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus.
Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que le tiers n’avait apporté aucune réponse à l’huissier de justice, se trouve légalement justifié.
En application des deux derniers alinéas de l’article R. 221-21 du code des procédures civiles d’exécution, auxquels renvoie l’article R. 522-5 du même code, l’huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts.
Il résulte de ces dispositions que si, après avoir exactement répondu sur-le-champ à l’huissier de justice, le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée lui fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de l’article 1240 du code civil.
L’arrêt relève, en premier lieu, par motifs propres, que l’huissier de justice chargé de pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de la société Amazon France services avait coché sur le procès-verbal la mention : « le tiers détenteur m’a déclaré ne détenir aucun bien appartenant au débiteur. J’en ai pris acte, attirant son attention sur les conséquences possibles et les sanctions rappelées ci-dessous ».
Il relève, en deuxième lieu, qu’interrogé le 22 février 2016 par l’huissier de justice instrumentaire concernant le « montant exact des sommes saisies », la société Amazon France services lui avait répondu le même jour en ces termes : « Nous revenons vers vous suite à votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016. La valeur totale du stock d’Elite GSM se trouvant dans les centres de distribution d’Amazon en France s’élève à 897 597,60 euros. Ce stock est réparti dans les quatre centres de distribution d’Amazon.fr Logistique SAS en France et nous vous confirmons qu’il a été bloqué depuis le 12 février 2016 au soir ».
Il relève, en troisième lieu, qu’interrogée à nouveau le 26 février suivant sur la localisation des stocks, la société Amazon France services avait répondu le 29 février suivant en ces termes : « Nous vous envoyons dans la journée le détail des stocks par centre de distribution en France. Nous envoyons également cette information pour les centres de Lille et Chalons aux deux huissiers qui se sont présentés dans ces centres ce matin. Pour ce qui est du contact, nous vous suggérons de nous contacter via cet email. Les équipes locales n’ont pas accès aux informations sur le stock ni aucune information sur le compte Elite GSM, ce compte étant bloqué depuis le 12 février. Madame Q… vous contactera également dans la journée ».
Il relève, en quatrième lieu, qu’à la suite d’une sommation interpellative du 2 mars 2016, la société Amazon France services avait répondu le 3 mars suivant en ces termes : « Nous faisons suite à la sommation interpellative que vous avez signifiée ce matin à la demande de la Selarl I…, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixmania. Nous relevons que cette sommation s’inscrit dans le prolongement des mesures conservatoires nouvellement réalisées entre les mains de la société Amazon FR Logistique, prise en ses quatre centres de distribution respectivement situés à Sevrey, Saran, Montélimar et Lauwin Plan et que cette sommation vise à vous remettre “le détail intégral et par site des stocks appartenant à la société Elite GSM, détenus par la société Amazon FR Logistique”.A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu’Amazon France services est une société de services dont l’activité est étrangère à la gestion et l’exploitation du site Internet www.amazon.fr, la société Amazon FR Logistique assurant de son côté, des prestations de stockage de marchandises proposées notamment sur la place de marché du site Internet www.amazon.fr. En outre, si ce n’est leur affiliation commune, Amazon France services et Amazon FR logistique sont deux entités juridiques indépendantes. Cela dit, nous vous avons, par email daté du 22 février dernier, apporté des informations sur l’état du stock de produits détenu, pour le compte d’Elite GSM, par Amazon FR Logistique, alors que nous n’étions pas tenus de le faire et qu’Amazon FR Logistique n’était pas visée par une mesure conservatoire. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les informations suivantes que nous détenons de la société Amazon FR Logistique : les déclarations faites les 29 février et 1er mars par la société Amazon FR Logistique à la suite de la réalisation entre ses mains de mesures conservatoires comportent déjà le détail du stock détenu à date par chacun de ces centres ainsi que leur valeur. Vous trouverez à cet effet, ci-joint, les éléments d’information communiqués par Amazon FR Logistique aux huissiers instrumentaires».
Il relève, en cinquième lieu, par motifs adoptés, que, sommée par la société Pixmania le 4 mars de justifier de la différence entre la valeur déclarée des stocks par la société Amazon France services, et de confirmer leur blocage au 12 février 2016, la société Amazon France Logistique avait répondu que les saisies conservatoires dans ses centres de distribution n’avaient été opérées que les 29 février et 1er mars 2016, qu’il n’avait pas été fait usage de l’autorisation du 12 février 2016 et, qu’en l’absence de saisie antérieure « le blocage du compte d’Elite GSM mentionné par la société Amazon France services a eu pour effet d’empêcher la réalisation de toutes transactions commerciales depuis la marketplace. Il ne pouvait en revanche empêcher d’éventuelles demandes de restitution formulées par la société Elite GSM. Or, c’est précisément ce qui s’est passé (…) ».
Ayant retenu, à bon droit, que quand bien même la société Amazon France services aurait satisfait sur-le-champ à son obligation déclarative, les réponses données les 22 et 29 février 2016 à l’huissier de justice l’engageaient, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la société Amazon France services avait commis une faute ayant occasionné un préjudice dont elle a apprécié souverainement l’étendue.
ENTREPRISE EN DIFFICULTE – RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS.
Cass., Com., 3 février 2021, n°19-20004.
Le 4 janvier 2012, la société Lorraine DA a été mise en liquidation judiciaire, la société […] étant désignée en qualité de liquidateur. Ce dernier a assigné M. et Mme W…, qui se sont succédé dans les fonctions de président de la société, en responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu’il tient de l’article L. 651-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélé à l’occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n’a pas ignoré cet état.
CONSOMMATION – RESPONSABILITE DU VENDEUR – DEFAUT DE CONFORMITE.
Cass., Com., 3 février 2021, n°19-13260.
La société italienne Ceramiche Marca Corona (la société CMC), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de carrelage, a vendu le 18 avril 2003 des produits à la société Malet matériaux, aux droits de laquelle est venue la société Bois et matériaux (le vendeur), laquelle les a revendus le 9 mai 2003 en France à M. et Mme O… (les acheteurs).
Soutenant que le carrelage présentait des micro rayures, ceux-ci ont assigné en indemnisation de leur préjudice leur vendeur, qui a appelé en garantie la société CMC (le fournisseur).
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Aux termes de l’article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes.
Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme O… du fait du défaut de conformité du carrelage qu’elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable.
Ayant écarté l’application des dispositions du code civil italien comme non pertinentes, dès lors qu’était en cause l’action récursoire du vendeur final contre un vendeur antérieur, puis retenu que l’article 131 du code italien de la consommation permettait au vendeur final reconnu responsable vis-à-vis du consommateur en raison d’un défaut de conformité d’exercer un recours contre tout sujet responsable faisant partie de la même chaîne distributive que lui, la cour d’appel a, par là-même, effectué la recherche prétendument omise.
La société CMC fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la société Bois et matériaux de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. et Mme O…, alors « que selon l’article 39 de la Convention de Vienne “1. l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle”. En écartant la déchéance invoquée en l’espèce au prétexte que la convention règle les relations contractuelles entre vendeur et acheteur y compris au titre d’une non-conformité dans l’hypothèse par exemple d’une difficulté née avant revente à un consommateur au sens de la directive et ne règle pas le recours récursoire de vendeur final contre son propre vendeur, la cour d’appel a violé l’article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980. »
Selon l’article 39 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
Pour condamner la société CMC à garantir la société Bois et matériaux, l’arrêt retient, en premier lieu, que l’action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur trouve sa cause non dans le défaut de conformité lui-même mais dans l’action engagée contre ce vendeur final par le consommateur, en second lieu, que la CVIM régit les relations contractuelles entre vendeur et acheteur et ne s’applique pas à un tel recours.
Il en déduit que le débat sur l’application des articles 39 et 40 de la CVIM est inopérant.
CONSOMMATION – TRANSFERT DE BIENS.
Cass., Civ., 1ère, 3 février 2021, n°19-21046.
M. X… (l’acheteur), soutenant ne pas avoir reçu des produits achetés le 2 décembre 2017 sur Internet à la société La Broderie de Lomagne (le vendeur), a, par déclaration au greffe, sollicité la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L. 216-4 du code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Pour rejeter la demande formée par l’acheteur, le jugement retient que La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n’est pas responsable, et que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acheteur n’avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur Internet, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.
AGENT COMMERCIAL – MANDAT.
Cass., Civ., 1ère, 3 février 2021, n°19-21403.
La société Burger Real Estate finance (la société BREF), qui a pour dirigeant M. H…, a constitué notamment deux sociétés dont elle est l’associé unique : les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ayant une activité d’agent immobilier et pour gérante Mme S…. Par contrat du 30 octobre 2013 complété par un avenant du 1er décembre 2015, signés par M. H… au nom de la société BREF, Mme S… s’est vu confier des fonctions de directrice commerciale. Par deux contrats du 1er janvier 2015, les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont confié à Mme S… un mandat d’agent commercial de prospection et de transaction de vente d’appartements, maisons et terrains. Ces actes ont été signés par Mme S… et par M. H….
Du 29 septembre 2017 au 26 juin 2018, la société Océan 24, constituée par Mme S… qui en est la gérante, a émis dix factures d’honoraires ou commissions sur des ventes ou locations, l’une à l’égard de la société Les Trois caps et les neuf autres à l’égard de la société Burger Real Estate. Les 31 décembre 2017 et 12 février 2018, Mme S… a émis à l’égard de la société BREF trois factures de primes conformes à l’avenant du 1er décembre 2015. Contestant les factures émises tant par la société Océan 24 que par Mme S…, la société BREF a rompu le contrat de direction générale conclu avec cette dernière. Les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont révoqué Mme S… de ses fonctions de gérante et ont obtenu, par ordonnance de référé du 31 août 2018, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et avoirs de la société Océan 24.
Par actes des 27 et 28 septembre 2018, la société Océan 24 a assigné les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps, devenues respectivement la société Côte d’Azur Sotheby’s Cannes et la société Côte d’Azur Sotheby’s Saint-Jean-Cap-Ferrat, aux fins de mainlevée des saisies pratiquées.
Ayant constaté que les contrats d’agent commercial conclus par les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps avec Mme S… avaient été signés par cette dernière ainsi que par M. H…, dirigeant de la société BREF, laquelle est l’unique associée de chacune des deux sociétés, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.
Si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier.
Ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que les deux contrats d’agent commercial consentis à Mme S… lui ouvraient une faculté de substitution, et relevé que la société Océan 24, que s’était substituée Mme S… dans l’exécution de ces deux contrats, exerçait elle-même l’activité d’agent immobilier, de sorte que les factures d’honoraires et de commissions émises par la société Océan 24 à l’égard des sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps, qui correspondaient à des prestations effectivement accomplies, étaient valables, la cour d’appel en a justement déduit que les créances alléguées par ces deux dernières sociétés n’étaient pas justifiées et que la mainlevée des saisies conservatoires devait être ordonnée.
– Libertés publiques et droit des étrangers –
APOLOGIE DU TERRORISME – STATUT DE REFUGIE.
CE, 12 février 2021, 2ème et 7ème Ch. Réunies, n°431239.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A…, de nationalité russe et d’origine tchétchène, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2011. Par une décision du 20 février 2017 prise en application du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A…, en estimant que, l’intéressé ayant fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2011 et 2016, dont une condamnation prononcée le 18 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 2 avril 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et rétabli M. A… dans le statut de réfugié.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des dispositions du 4. de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 : ” Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (…) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société (…) “. Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives, dont l’une est d’avoir fait l’objet d’une des condamnations qui y sont limitativement énumérées.
Aux termes de l’article L 421-2-5 du code pénal, issu de la loi du 14 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme : ” Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. / Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables “. Si le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme prévu par ces dispositions figure dans le chapitre du titre II du livre IV du code pénal intitulé ” Des actes de terrorisme “, il n’a pas été qualifié, à la différence d’autres infractions du même chapitre, d'” acte de terrorisme “, ainsi, d’ailleurs, que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018.
Pour juger que la première condition posée par le 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à l’existence d’une des condamnations qui y sont énoncées, n’était pas remplie et en déduire qu’il ne pouvait être fait application de cette disposition pour mettre fin au statut de réfugié de M. A…, la Cour nationale du droit d’asile a relevé que les délits ayant donné lieu aux condamnations de celui-ci étaient punis de peines inférieures à dix ans d’emprisonnement et que les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour lesquels il avait été condamné le 18 février 2015 ne constituaient pas un acte de terrorisme. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en statuant ainsi, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait, en conséquence de son erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce doit, dès lors, être également écarté.
En second lieu, les moyens contestant la décision litigieuse en tant qu’elle se prononce sur le maintien de la qualité de réfugié de M. A… et sur la seconde condition nécessaire pour mettre fin au statut de réfugié, tenant à la menace grave pour la société, sont dirigés contre des motifs surabondants de cette décision. Ils sont, par suite, inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFPRA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque.
Le délit d’apologie publique d’acte de terrorisme n’est pas un acte de terrorisme. Il ne justifie pas, à lui seul, qu’il soit mis fin au statut de réfugié.
– European Court of Justice –
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING – ASYLUM AND IMMIGRATION – DIRECTIVE 2008/115/EC – ARTICLES 3, 4, 6 AND 15 – REFUGEE STAYING ILLEGALLY IN THE TERRITORY OF A MEMBER STATE – DETENTION FOR THE PURPOSE OF TRANSFER TO ANOTHER MEMBER STATE – REFUGEE STATUS IN THAT OTHER MEMBER STATE – PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT – NO RETURN DECISION – APPLICABILITY OF DIRECTIVE 2008/115.
ECJ, 24 February 2021 Ca,se C-673/19, M and Others v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid and T.
Articles 3, 4, 6 and 15 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals must be interpreted as not precluding a Member State from placing in administrative detention a third-country national residing illegally on its territory, in order to carry out the forced transfer of that national to another Member State in which that national has refugee status, where that national has refused to comply with the order to go to that other Member State and it is not possible to issue a return decision to him or her.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING – ARTICLE 45 TFEU – FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS – ARTICLE 49 TFEU – FREEDOM OF ESTABLISHMENT – ARTICLE 56 TFEU – FREEDOM TO PROVIDE SERVICES – CARRYING OUT OF PORT ACTIVITIES – DOCKERS – ACCESS TO THE PROFESSION AND RECRUITMENT – ARRANGEMENTS FOR THE RECOGNITION OF DOCKERS – DOCKERS NOT PART OF THE QUOTA OF WORKERS PROVIDED FOR IN NATIONAL LEGISLATION – LIMITATION OF THE DURATION OF THE WORK CONTRACT – MOBILITY OF DOCKERS BETWEEN DIFFERENT PORT AREAS – WORKERS CARRYING OUT LOGISTICAL WORK – SAFETY CERTIFICATE – OVERRIDING REASONS IN THE PUBLIC INTEREST – SAFETY IN PORT AREAS – PROTECTION OF WORKERS – PROPORTIONALITY.
ECJ, 11 February 2021, Joined Cases C-407/19 and C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals NV and Others v Belgische Staat and Ministerraad.
Articles 49 and 56 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation which obliges persons or undertakings wishing to carry out port activities in a port area – including activities which, strictly speaking, are unrelated to the loading and unloading of ships – to have recourse only to dockers recognised as such in accordance with the conditions and arrangements laid down pursuant to that legislation, provided that those conditions and arrangements, first, are based on objective, non-discriminatory criteria known in advance and allow dockers from other Member States to prove that they satisfy, in their State of origin, requirements equivalent to those applied to national dockers and, second, do not establish a limited quota of workers eligible for such recognition.
Articles 45, 49 and 56 TFEU must be interpreted as precluding national legislation under which:
– the recognition of dockers falls to an administrative committee composed jointly of members designated by employers’ organisations and by workers’ organisations;
– that committee also decides, according to the need for labour, whether or not recognised dockers must be included in a quota of dockers, it being understood that, for dockers not included in that quota, the duration of their recognition is limited to the duration of their employment contract, such that a new recognition procedure must be initiated for each new employment contract that they conclude, and
– no maximum period within which that committee must act is prescribed.
Articles 45, 49 and 56 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation under which, unless he or she can show that he or she satisfies equivalent conditions in another Member State, a worker must, in order to be recognised as a docker:
– be declared medically fit for port work by an external prevention and protection at work service, to which is affiliated an organisation to which all employers active in the port area concerned must obligatorily become affiliated;
– pass the psychotechnical tests conducted by the body designated for that purpose by that employers’ organisation;
– attend a three-week preparatory course relating to work safety and obtaining a professional qualification, and
– pass the final test,
in so far as the role conferred on the employers’ organisation and, as the case may be, on the recognised dockers’ unions in the designation of the bodies responsible for conducting such examinations or tests is not such as to call into question the transparent, objective and impartial nature of those examinations or tests.
Articles 45, 49 and 56 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation under which dockers, recognised as such in accordance with the statutory regime that was applicable to them before the entry into force of that legislation, retain, pursuant to that legislation, the status of recognised docker and are included in the quota of dockers provided for in that legislation.
Articles 45, 49 and 56 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation which provides that the transfer of a docker to the quota of workers of a port area other than that in which he or she obtained his or her recognition is subject to conditions and arrangements laid down by a collective labour agreement, provided that those conditions and arrangements prove necessary and proportionate to the objective of ensuring safety in each port area, which is for the national court to determine.
Articles 45, 49 and 56 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation which provides that logistics workers must hold a ‘safety certificate’, issued on presentation of their identity card and employment contract and whose issuance modalities and obtainment procedure are fixed by a collective labour agreement, provided that the conditions for the issue of such a certificate are necessary and proportionate to the objective of ensuring safety in port areas and the procedure prescribed for its obtainment does not impose unreasonable and disproportionate administrative burdens.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING – CONSUMER PROTECTION – DIRECTIVE 93/13/EEC – UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS – ARTICLES 3(1), 4(1) AND 6(1) – ASSESSMENT OF THE UNFAIRNESS OF CONTRACTUAL TERMS – TERM FIXING IN ADVANCE THE CREDITOR’S POTENTIAL ADVANTAGE IN THE EVENT OF TERMINATION OF THE CONTRACT – SIGNIFICANT IMBALANCE IN THE PARTIES’ RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT – DATE ON WHICH THE IMBALANCE MUST BE ASSESSED – FINDING THAT A TERM IS UNFAIR – CONSEQUENCES – REPLACEMENT OF AN UNFAIR TERM WITH A SUPPLEMENTARY PROVISION OF NATIONAL LAW.
ECJ, 27 January 2021, Joined Cases C-229/19 and C-289/19, Dexia Nederland BV v XXX and Z.
The provisions of Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that a term in a risk-weighted contract concluded between a seller or supplier and a consumer, such as share leasing agreements, must be regarded as unfair, since, having regard to the circumstances surrounding the conclusion of the contract in question and by reference to the date of its conclusion, that term may create a significant imbalance between the rights and obligations of the parties during the performance of the contract, even though that imbalance could occur only if certain circumstances were to arise and, in other circumstances, that term could even benefit the consumer. In those circumstances, it is for the referring court to ascertain, in the light of the circumstances attending the conclusion of the contract, whether a term fixing in advance the advantage which the seller or supplier is to enjoy in the event of premature termination of the contract was, from the time that contract was concluded, liable to create such an imbalance.
The provisions of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that a seller or supplier which has imposed on a consumer a term declared unfair and, consequently, void by the national court cannot claim the statutory compensation provided for by a supplementary provision of national law which would have been applicable in the absence of that term where the contract is capable of continuing in existence without that term.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING – DIRECTIVE 76/308/EEC – ARTICLES 6 AND 8 AND ARTICLE 12(1) TO (3) – MUTUAL ASSISTANCE FOR THE RECOVERY OF CERTAIN CLAIMS – EXCISE DUTY PAYABLE IN TWO MEMBER STATES FOR THE SAME TRANSACTIONS – DIRECTIVE 92/12/EC – ARTICLES 6 AND 20 – RELEASE OF PRODUCTS FOR CONSUMPTION – FALSIFICATION OF THE ACCOMPANYING ADMINISTRATIVE DOCUMENT – OFFENCE OR IRREGULARITY COMMITTED IN THE COURSE OF MOVEMENT OF PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE DUTY UNDER A DUTY SUSPENSION ARRANGEMENT – IRREGULAR DEPARTURE OF PRODUCTS FROM A SUSPENSION ARRANGEMENT – ‘DUPLICATION OF THE TAX CLAIM’ RELATING TO THE EXCISE DUTIES – REVIEW CARRIED OUT BY THE COURTS OF THE MEMBER STATE IN WHICH THE REQUESTED AUTHORITY IS SITUATED – REFUSAL OF THE REQUEST FOR ASSISTANCE MADE BY THE COMPETENT AUTHORITIES OF ANOTHER MEMBER STATE – CONDITIONS.
ECJ, 24 February 2021, Case C-95/19, Agenzia delle Dogane v Silcompa SpA.
Article 12(3) of Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures, as amended by Council Directive 2001/44/EC of 15 June 2001, read in conjunction with Article 20 of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products (OJ 1992 L 76, p. 1), as amended by Council Directive 92/108/EEC of 14 December must be interpreted as meaning that, in the context of an action disputing enforcement measures taken in the Member State in which the requested authority is situated, the competent body of that Member State may refuse to grant the request to recover excise duties submitted by the competent authority of another Member State in respect of goods which irregularly departed from a suspension arrangement, for the purposes of Article 6(1) of Directive 92/12, where that request is based on the facts relating to the same export transactions which are already subject to excise duty recovery in the Member State in which the requested authority is situated.


